Editions BELFOND/UNESCO, Ouvrage traduit avec le concours du Centre National des lettres,París, 1991, 425 p.
 Des Caraïbes à la Patagonie, cette Anthologie rassemble les nouvelles de cinquante trois auteurs contemporains qui mêlent aujourd'hui leur voix à celles des écrivains latino-américains désormais reconnus du public français. Elle propose un panorama de l'ensemble des tendences d'une production littéraire féconde et toujours renouvelée.
Des Caraïbes à la Patagonie, cette Anthologie rassemble les nouvelles de cinquante trois auteurs contemporains qui mêlent aujourd'hui leur voix à celles des écrivains latino-américains désormais reconnus du public français. Elle propose un panorama de l'ensemble des tendences d'une production littéraire féconde et toujours renouvelée.(...)Plus avant le mois d'octobre, on vit les poissons dorés, les poissons volants, les cachalots. Un bois sculpté fit son apparition près d'un des navires; L'amiral vit une flemme se dresser au loin. Et il promit un pourpoint de soie à celui qui verrait la terre le premier.Au petit jour, un long cri annonça que la terre était en vue.Vient en suite une autre histoire, dure, sanglante, écartelée, terrible, plus de quatre cents après, où nous admirons encore ce bouquet de feu et le passage des oiseaux ".
Adriano González-León, "Bouquet de feu dans la mer", extrait traduit par François Delprat, in: Anthologie de la Nouvelle Latino-américaine.
Car il y a bien une unité et multiciplité dans ce continent dont les différents pays ont partagé une même trajectoire historique pour ensuite affirmer séparément leur existence. Si les auteurs expriment ici un grand nombre de problématiques de l'Amérique Latine, le thème récurrent de la violence notamment, ils se réapproprient cepandant dans leurs textes un droit fondamental: le droit au rêve.
"Dans ce volume, nous avons voulu présenter un panorame littéraire du continent, tel qu'il se présent après la phase du "boom". C'est ainsi que l'on pourra découvrir dans les nouvelles de l'anthologie, sous la plume de nombreux écrivains, un grand nombre de problématiques qui ont été celles de la société latino-américaine dans son ensemble.La violence, celles de luttes de libération ou, sortout, celle de la répression des dictatures, apparaît comme l'un des thèmes récurrents. Le spectre de la peur, le cauchemar, et l'horreur s'estompent peu à peu dans les textes postérieurs aux périodes les plus sombres; l'espoir et le sens de la dignité collective retrouvent droit de cité dans une communauté qui voit renaître la démocratie, cette petite plante, fragile que nourrit le verbe solidaire et enthousiaste des écrivains. Les auteurs rendent compte de la réappropriation d'un droit findamental : le droit au rêve.
R.B.S /O. de L. Extrait de l'Introduction à : l'anthologie de la nouvelle latino-américaine.
Olver Gilberto De León - Rubén Bareiro-Saguier -
BOLIVIE
BRESIL
CHILI
COLOMBIE
COSTA RICA
CUBA
EQUATEUR
GUATEMALA
HONDURAS
MEXIQUE
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PEROU
PORTO RICO
REPUBLIQUE DOMINICAINE
SALVADOR
URUGUAY
VENEZUELA
Les éditions Belfond ont eu, il y a dix ans, l’heureuse idée d’offrir à notre curiosité une "Anthologie de la nouvelle hispano-américaine". Celle-ci, la deuxième (1), procure à son lecteur les plaisirs d’un voyage à travers des paysages mentaux et géographiques divers, parfois étranges, souvent bouleversants. L’Amérique latine, aujourd’hui comme hier, n’est pas un espace neutre abrité sous un ciel serein . Elle est la terre des violences extrêmes. Ruben Bareiro-Saguier et Olver Gilberto de León, maîtres d’oeuvre de l’ouvrage, nous en avertissent. : « Nous avons voulu présenter un panorama littéraire du continent tel qu’il se présente après la phase du « boom « (…). On pourra découvrir sous la plume de nombreux écrivains, un grand nombre de problématiques qui ont été celles de la société latino-américaine dans son ensemble. La violence, celle des luttes de libération ou, surtout, celle de la répression des dictatures, apparaît comme l’un des thèmes récurrents ».
Un tableau, le Cri, a fait à lui seul la gloire du peintre Edward Munch. Et peut-être n’est-il pas dû au hasard – dans la monographie qu’Ulrich Bischoff consacre à l’artiste – que l’homme marchant sur un pont, les yeux et la bouche arrondis par l’horreur, les mains sur les oreilles pour ne plus entendre, ait été placé en regard d’une momie péruvienne dont les mains parcheminées soutiennent un crâne aux orbites et à la mâchoire remplies de nuit et d’épouvante. Le Cri, un semblable cri d’horreur et de dégoût, traverse les territoires de cette anthologie.
Enrique Medina (Argentine), dans les Hyènes, nous décrit le mince univers mental du tueur professionnel, ouvrier hautement spécialisé de l’exécution sans bavures de qui l’on voudra, de l’opposant politique de préférence, obsédé du décrassage, perfectionniste à la conscience propre, impeccable (« personne ne peut rien me reprocher »), ennemi de l’anarchie sous toutes ses formes, à qui il arrive de « travailler » en duo, avec un exécuteur sadique (lui n’est que technicien) qui l’étonne plus qu’il ne l’écoeure. Et s’il meurt, c’est en appréciant à sa juste valeur le savoir-faire de qui lui loge une balle dans la tête.
La mort, dans nombre de ces récits, est le point focal, l’alpha ou l’oméga, La vie humaine est ici cotée à son plus bas prix, comme en témoigne cet écho de » la vie qui déjà n’existe plus que dans les mots » (Cristina Siscar, Argentine). Comme en témoigne singulièrement Un cri au milieu du silence (César Verduguez Gómez, Bolivie), dont le sujet est celui, ordinaire au point d’être parvenu à nos oreilles, de la disparition. Tout y est exprimé de l’incompréhension, de la douleur d’une mère qui ne se lasse pas de rechercher son fils. Vite nous comprenons que l’allusion, l’ellipse sont des luxes démocratiques, des afféteries de littérateurs qui ne connaissent de plus grands périls que le pléonasme sournois, la redondance satisfaite. Et la leçon est tirée sur le ton de l’évidence : « Ce n’est pas l’histoire qui se répète, c’est l’humanité qui ne change pas (…). Elle est comme arrêtée (…). Elle ne va nulle part. Elle est là, c’est tout. » Faut-il que le sentiment d’impuissance soit tel qu’il ait éteint jusqu’au désir d’espoir ? Que tous les crimes soient à jamais celui de Caïn : « Ils pensent que c’est une répétition, mais en réalité c’est le même crime. » ? Il semble que la gangrène s’en prenne à la fois à tous les membres et organes du continent américain : C’est le Chilien Fernando Jérez nous décrivant cette violence à effet lent, qui sur les chômeurs sans remède, réduits à faire semblant de manger pour tromper leur faim ; c’est le Salvadorien Manlio Argueta nous psalmodiant, incantatoire, obsessionnelle, une violence totalement imprégnatrice ; et l’on ne sait qui du Péruvien Harry Belevan ou de l’Uruguayen Tomás de Mattos, clôt le mieux ce chapitre : le premier, dans un récit très original, nous fait connaître la mort et la résurrection supposées de Grégoire Samsa, sa vie familiale ultérieure et sa seconde mort, nous posant la question implicite : que faut-il préférer de la condition humaine ou de celle de la blatte répugnante et solitaire ? Le second, dans Femme de Batovi, nous décrit l’ordinaire, le naturel et les fichus inconvénients du crime sous certaines latitudes. Une femme en est la victime. Les enquêteurs de conclure :
« C’était comme égorger une poule. Encore pire, répond Gutierez à l’arrière, une poule, ça ne laisse pas de meubles pour emmerder le monde. »
En contrepoint - avec pour source secrète ou pour fil d’Ariane la même violence – la fantaisie (le mot, en espagnol, ne signifie-t-il pas imagination ?) se crée un espace particulier dans l’anthologie.
L’Argentin Héctor Tizón la trouve dans une bicyclette, innocent instrument de progrès et de locomotion qui ne réussira qu’à vider un village de ses habitants. La fuite comme seule solution ! Quand elle est brésilienne, l’imagination se tient aux frontières de la folie, avec Ligia Fagundes Telles ; elle nous dit aussi (Rubem Fonseca, Gazelle) que l’amour jaillit et meurt, quoique désirable et impossible, infiniment, dans les trains et les jardins, et qu’il est « un voyage plein de peurs ». Superbe nouvelle !
Le Colombien Jorge Eliécer Pardo (la Huitième porte) nous convainc de ce que l’on peut, aujourd’hui encore, rencontrer Lilith, l’Eve noire, à condition de frapper à la bonne porte. Le Cubain Severo Sarduy nous fait goûter la savoureuse tisane que Cocuyo, l’enfant à la grosse tête, prépare pour sa famille. Quand le discours est impuissant à émouvoir les êtres-« Il arrive que devant ce qu’il faut dire, les mots se ramollissent et pendent flasques et baveux comme des langues de pendus »-, il faut agir.
L’Equatorien Raul Vallejo Corral, dans Une marionnette égarée sur la scène, montre comment, de pirandellienne façon, l’auteur s’empare du personnage, le fait «prisonnier de ses mots » et in fine, rattrape la vie pour la rendre à sa marionnette. Le nicaraguayen Lizandro Chávez Alfaro, dans une fulgurante hallucination de mots, nous fait vivre sa Vision de totalité. Avec La Sécheresse, le Paraguayen Rodrigo Díaz Pérez dépeint l’image du temps de vie dans celle, métaphorique, du jardin où se rencontrent, quoique contemporains, deux mondes humains que tout oppose. Les Indiens, étrangement, ou logiquement, selon l’interprétation, semblent jouer les seconds rôles dans cette anthologie. Néanmoins, ils sont durement présents. Pour le Colombien Evelio José Rosero, ce qui les définit c’est ce qu’ils endurent, dans la terreur muette et l’impuissance, le viol d’une fillette de la tribu, le viol de tous les Indiens depuis que l’homme blanc a enfoncé la porte de la maison Amérique. Julio Ortega (Pérou) sait que l’on ne reconstituera plus jamais que dans le secret, dans le non-dit ou l’interdit, la statuette, le Corps de la déesse : « Mes larmes ont coulé car je savais que nous étions venus pour cela, pour réunir et reconnaître ce corps, puis cacher dans notre propre corps les parties morcelées de la déesse antique qui nous rendrait l’or et le sang perdus »
Sur ce point, laissons les derniers mots au Vénézuelien Adriano González-León qui, heureux hasard, avec Bouquet de feu dans la mer, clôt cette remarquable anthologie. « L’étroitesse du monde, constatée de tout temps par les hommes, a imposé le besoin d’en inventer un autre », nous dit-il. Un autre? Tous les mondes ici inventés – drogue, sexe, violence, rêve, crime, merveilleux, littérature surtout- se trouvent expliqués dans cette seule constatation. Christophe Colomb, à l’étroit dans son monde, s’en découvre, nous en découvre un autre. Il cherchait l’Inde, il trouve les Indes et l’Age d’OR, que lui signale, dans le ciel, « un merveilleux bouquet de feu ». Depuis, les Indiens d’Amérique connaissent l’Age de fer : « Au petit jour, un long cri annonça que la terre était en vue. Vient ensuite une autre histoire, dure, sanglante, écartelée, terrible, plus de quatre cents années après, où nous admirons encore ce bouquet de feu et le passage des oiseaux. »
Entre songe et réalité, par des détours obligés ou insoupçonnés, ce recueil de nouvelles fixe les images aveuglantes de l’Amérique latine d’aujourd’hui.











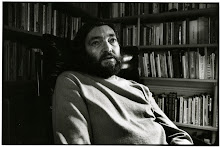


















No hay comentarios:
Publicar un comentario